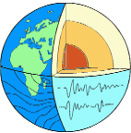Cycles de l’eau, du carbone, érosion et couplage fluide-roche
L’équipe « Surface et Réservoir » est une équipe pluridisciplinaire, dont les activités se focalisent sur les sols et sous-sols, et les flux de matière (érosion), de carbone et d’eau. Ces thématiques sont liées à l’atmosphère et au climat, que ce soit à des échelles de temps i) paléoclimatiques (formation de bassin sédimentaire, géothermie), ii) de l’événement météorologique (érosion, éboulement de terrain, crue, sécheresse) ou iii) du siècle à venir (évolution/répartition des stocks de carbone et de la ressource en eau). Pour cela, l’équipe mobilise des méthodes expérimentales en laboratoire, instrumente des sites de mesures (répartis dans différentes régions : zones tropicales, Asie, Europe…), analyse les données et développe des modélisations. Une des particularités de l’équipe est sa bonne connexion avec des gestionnaires (ADEME, Agences de l’eau, AFB), des collectivités territoriales françaises (Région, Ville de Paris) ou étrangères, ainsi qu’avec des industriels/EPIC (travaillant sur les hydrocarbures et le stockage de carbone). L’équipe « Surface et Réservoir » fait partie de l’Institut Pierre-Simon Laplace.
Les personnes
Des financements de thèses et post-doc diversifiés
ADEME, BRGM, Contrats industriels, CSC (Chine), IFPEN, Labex Matisse, Météo-France, Ville de Paris…
13 Doctorant·es
B. Benitez – C. Daigre – G. Demorcy – J. Douçot – G. Flores – L. Gang – E. Gros
M. Guillou – B. Hulin – M. Lusseyran – A. Manlay – J. Piketty – A. Ternon
15 Post-docs
M. Alencar – T. Briolet – E. Bruni – S. Diop – M. Guilbert – F. Kialka – J. Lebrun Thauront
M. Moradzadeh – L. Pacini – M. Sonnet – A. Stegehuis – M. Stojanova – H. Xu – J. Xue – Y. Zhou
Une équipe de chercheur-e-s et d’enseignant-e-s chercheur-e-s pluridisciplinaire
biogéochimistes des sols, géomorphologues, hydrogéologues, mécaniciens des roches, géophysiciens
10 Permanent·es
S. Abiven (ENS) – P. Barré (CNRS 30) – S. Chapman (IR) – C. Dalin (CNRS 30) – P. Delorme (ENS)
J. Fortin (CNRS 9) – B. Guenet (CNRS 30) – F. Habets (CNRS 30) – P. Meunier (ENS) – S. Violette (SU)
2 Émérites et Bénévoles
C. Laj – J.-P. Pozzi
Les projets
MRV4SOC
Funding: H2020 / People involved in the lab: Yue Zhou, Souleymane Diop, Bertrand Guenet
MRV4SOC vise à concevoir une approche de niveau 3 complète, robuste et rentable, tenant compte des changements dans le plus grand nombre possible de réservoirs de carbone, afin d’estimer les GES et les bilans complets de carbone, de coupler les cycles du carbone et de l’azote, de quantifier l’accumulation de carbone organique dans le sol (COS) et d’évaluer les résultats des pratiques de gestion traditionnelles et de la culture du carbone. Les principaux défis abordés par le MRV4SOC sont les suivants : i) surveiller les changements dans l’accumulation de COS dus au changement climatique et aux pressions socio-économiques ; ii) tenir compte des cycles du carbone et de l’azote dans les bilans complets du carbone ; iii) développer une méthodologie de niveau 3 scientifiquement fondée, normalisée et transparente à différentes échelles ; iv) mettre en œuvre des données in situ et des données de RS de haute qualité pour tester les méthodes et les mettre à l’échelle ; iv) normaliser les systèmes de surveillance, de déclaration et de vérification pour garantir la transparence, la robustesse et la rentabilité ; et v) un manque de confiance dans les marchés volontaires du carbone. Pour surmonter ces défis, MRV4SOC développera 6 objectifs spécifiques, qui seront mesurables, vérifiables et contrôlés par le biais d’indicateurs de performance clés (KPI) visant des cibles spécifiques. MRV4SOC propose un plan de travail triennal complet qui va de l’évaluation des réservoirs de carbone dans 9 classes d’utilisation des sols et de couverture végétale situées dans 14 sites de démonstration. MRV4SOC vise à concevoir une approche de niveau 3 complète et robuste qui tienne compte des changements dans autant de réservoirs de carbone que possible (biomasse aérienne, biomasse souterraine, litière, bois mort, carbone organique du sol et produits ligneux récoltés), en parfaite adéquation avec les rapports nationaux sur les émissions de gaz à effet de serre. MRV4SOC cherche à développer des solutions applicables à différentes échelles spatio-temporelles et scénarios de changement climatique et validées pour une grande variété d’écosystèmes dans les zones climatiques arides, tempérées et continentales en collaboration avec les parties prenantes locales. L’approche proposée permettra d’établir des crédits agricoles fiables et transparents dans un cadre méthodologique de surveillance, de déclaration et de vérification (MRV) rentable.
ALAMOD
Funding: Pepr FairC / People involved in the lab: Elisa Bruni, Annemiek Stegehuis, Pierre Barré, Bertrand Guenet
L’augmentation ou la diminution des stocks de carbone dans les écosystèmes continentaux (sol et biomasse) aura un impact significatif sur la concentration en CO2 atmosphérique et donc sur le climat. De ce fait, il est crucial de pouvoir disposer de modèles prédictifs à même de pouvoir simuler le plus précisément possible les évolutions de stocks de carbone. Le test et la validation de ces modèles nécessitent de disposer de mesures de stocks espacées dans le temps. De tels jeux de données sont de grande valeur car ils ne sont pas simples à produire. En effet, les stocks de C dans les sols évoluant peu à l’échelle de l’année, les sites et réseaux d’intérêt doivent avoir été suivis pendant une dizaine d’années au minimum. La communauté de recherche française maintient plusieurs réseaux/sites présentant des mesures d’évolution des stocks de C. Cependant, ces jeux de données sont dispersés, parfois incomplets ou difficilement disponibles. Les objectifs du projet ALAMOD sont (1) de recenser et compléter les jeux de données produits par les sites/réseaux présentant des évolutions de stocks de C (sol et biomasse) opérés par la communauté française ; (2) de développer des méthodes innovantes basées sur la spectroscopie IR et l’imagerie satellite pour compléter ces jeux de données ; (3) de développer un entrepôt et un portail de données pour mettre à disposition ces jeux de données rendus interopérables ; (4) de comparer les modèles de dynamique du C dans les écosystèmes développés par la communauté française sur ces jeux de données ; (5) d’améliorer ces modèles ou d’en développer de nouveaux pour pouvoir simuler avec précision les évolutions de stocks de C à différentes échelles spatiales et pour différentes couvertures végétales. ALAMOD capitalisera sur les données produites et le savoir-faire de plusieurs infrastructures de recherche (AnaEE, IN-SYLVA, ICOS…) qui seront fortement impliquées dans la réalisation du projet. Il mobilisera également de manière exhaustive la communauté française utilisant et développant des modèles de simulation d’évolution des stocks de C dans les écosystèmes terrestres. La réalisation de ce projet fédérateur permettra la mise à disposition d’un outil d’évaluation de modèles sans précédent et de modèles très performants, ce qui garantira à ALAMOD d’avoir des impacts très forts dans le domaine académique et au-delà.
CLIM-FAS
Funding: Pepr FairC / People involved in the lab: Jie Xue, Moradzadeh Mostafa, Bertrand Guenet
CLIM-FAS vise à améliorer les connaissances à la fois sur la contribution et le potentiel d’atténuation du secteur agricole français au changement climatique et à générer des preuves scientifiques de l’efficacité économique et juridique d’un éventail d’actions publiques d’atténuation de ce phénomène. Les principaux objectifs sont (i) de fournir une estimation robuste des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’agriculture sous climat actuel et futur, en tenant compte de la variabilité spatiale, de l’hétérogénéité des exploitations et de la diversité des pratiques agricoles, (ii) de dresser un bilan critique de certaines politiques et législations existantes ciblant les émissions et les puits de GES, et (iii) de concevoir et de proposer des dispositifs innovants directement utilisables par les décideurs publics et les parties prenantes.
SHARING-MED
Funding: PRIMA / People involved in the lab: Elisa Bruni, Bertrand Guenet
L’objectif général de SHARInG-MeD est de mettre en place un système ouvert et concerté de surveillance des sols afin d’intégrer des indicateurs physico-chimiques, biologiques (microbes, nématodes, invertébrés, plantes), agronomiques, économiques et environnementaux des terres cultivées méditerranéennes ; de construire des modèles des propriétés des sols à grande échelle ; des changements des propriétés des sols à petite échelle ; la relation entre les pratiques de gestion des terres ou des cultures (en particulier des sols) et les performances environnementales et économiques des systèmes agricoles ou des cultures ; les modèles d’harmonisation des données sur les sols entre diverses bases de données publiques ; et favoriser la diffusion des pratiques d’amélioration des sols (agriculture de conservation, application de matières organiques, utilisation de microbes bénéfiques) dans les zones arides méditerranéennes, en particulier en Asie occidentale et en Afrique du Nord (AOAN). Une promotion active des avantages et des limites de ces stratégies (utilisation des terres et changement d’utilisation des terres, pratiques de conservation, amendements organiques et microbes bénéfiques) et de la mission Horizon Europe sur les sols sera effectuée par le biais d’un site web, d’activités de médias de masse et sociaux, de magazines et de publications scientifiques, de photos, de vidéos, de congrès, de cours au lycée, d’écoles d’agriculteurs et d’un cours en ligne ouvert à tous sur les activités du projet. Ces données et modèles amélioreront la durabilité de l’agriculture en informant les parties prenantes sur l’utilisation et les relations entre ces indicateurs pour la gestion durable des paysages et des cultures méditerranéens et fourniront un outil pour moduler la contribution de l’agriculture à l’atténuation du changement climatique.
MOSS
Funding: Marie Skłodowska-Curie / People involved in the lab: Filip Kialka, Bertrand Guenet
La disposition spatiale des solides et des pores dans le sol (structure du sol) est une source majeure de variabilité des propriétés hydrauliques des sols. C’est en modifiant la structure du sol que l’activité biologique, la gestion des terres ou le passage du temps (y compris les cycles humidité-sécheresse et gel-dégel) affectent la capacité du sol à retenir et à évacuer l’humidité. Néanmoins, la structure du sol n’est représentée que timidement dans les modèles du système terrestre. Par conséquent, nous ne pouvons pas quantifier l’effet de l’activité biologique et de la gestion sur la teneur en eau du sol et donc leur effet total sur le climat régional ou le puits de carbone terrestre. Il s’agit là d’une lacune importante dans notre compréhension de l’environnement naturel, ainsi que d’un point aveugle potentiel dans notre réponse à l’urgence climatique. Il est difficile d’inclure la structure du sol dans les modèles de la surface terrestre, car son effet sur les propriétés hydrauliques du sol ne peut être prédit de manière fiable sur la base d’une seule quantité facile à mesurer, telle que la densité apparente. En même temps, les données plus détaillées sur la structure du sol et les méthodes permettant de les intégrer font largement défaut. MOSS abordera ces questions en 1)~développant une méthode basée sur la physique pour incorporer des informations sur la structure du sol au-delà de la densité dans les modèles de propriétés hydrauliques du sol, 2)~mettant en œuvre cette méthode dans un modèle de système terrestre de pointe, et 3)~utilisant le nouveau modèle pour quantifier l’impact de la structure du sol sur le puits de carbone terrestre. Ce faisant, MOSS démontrera probablement que la structure du sol doit être incluse dans les modèles numériques et protégée sur le terrain. De plus, la méthode développée par MOSS sera applicable aux modèles agronomiques et hydrologiques et aura donc un impact plausible sur les décisions politiques socialement et économiquement importantes que ces modèles prennent.
FLORA – “Sustainable and healthy food solutions: system dynamics and trade-offs”
ERC Starting Grant – Carole Dalin [PI], Marcellin Guilbert [postdoc], Jasmine Gamblin [post-doc], Belén Benitez [PhD student]
Flora’s webpage
Food systems are crucial to end hunger, but also to mitigate and adapt to climate change, to protect and restore biodiversity, to ensure human health and well-being, to end poverty, and to support sustainable communities. While hunger has receded, food systems are causing increasingly severe damage to our environment and health.
The FLORA project (“Sustainable and healthy food solutions: system dynamics and trade-offs”) will contribute to a transformation of global agri-food production, trade, and consumption necessary to achieve sustainable and healthy food systems.
The project will create essential evidence to identify and implement the shifts in practices and behaviours needed to effectively achieve this transformation, by:
– making a diagnosis of the integrated health and environmental outcomes of food systems globally, from the production and consumption perspectives, with innovative measures of sustainability,
– identifying key threats and opportunities with system dynamics and complex network analyses, and
– targeting and evaluating tailored solutions with an interdisciplinary modelling framework.
The project will enable the identification of most effective, targeted solutions by considering trade-offs, synergies, and dynamics of key food systems components. Global in scope, it sets the ambitious goal to overcome barriers in current approaches by taking a systemic approach and establishing a robust, interdisciplinary framework supported by empirical advancements to tackle complex food systems challenges.
PREF-Alim – “TRANSITIONS TOWARDS CARBON-NEUTRAL FOOD SYSTEMS PREFERENCES, CONSUMER WELFARE & PUBLIC POLICIES”
Project led for PEPR FairCarbon by Fabrice Etilé (INRAE) with the participation of Carole Dalin
SHEFS-SA – “Sustainable and Healthy Food Systems in Southern Africa“
Project led for Wellcome Trust by Rob Slotow (UKZN, South Africa) with the participation of Carole Dalin
The initial SHEFS project, which ran from 2017 to 2024, has significantly enhanced our understanding of the complex interconnections between food systems, health, and the environment. This success is attributed to its multidisciplinary research and extensive stakeholder engagement. As the Wellcome Trust-funded work transitions from SHEFS to SHEFS-SA, which will run for a further six years, the group is focused on integrating the valuable insights gained, addressing any gaps identified, and taking forward any important questions that remain unanswered.
The SHEFS project highlighted the necessity for localised solutions, adaptable strategies, and a stronger focus on gender equity and social inclusion. It also demonstrated the value of the deliberate development of a transdisciplinary Community of Practice that brings together diverse stakeholders who share common goals and interests within an expanded climate sensitive SHEFS-SA framework, thus enhancing knowledge co-production, building relationships and the capacity to bring about change, improve food security, food safety, nutrition, and health – including mental health.
Building upon the solid foundation of SHEFS, SHEFS-SA aims to incorporate key learnings and address existing gaps. This includes developing context-specific strategies tailored to Southern Africa’s unique challenges and opportunities, implementing a comprehensive Monitoring, Evaluation, Learning, and Impact Assessment (MELIA) plan, and formulating a thorough Gender, Equity, and Social Inclusion (GESI) strategy to ensure interventions are inclusive, equitable, and empower marginalised groups. SHEFS-SA will maintain the emphasis on building a Global South-led Community of Practice, expanding the network to include partners from Malawi and Zimbabwe, and from new fields as the scope of the work has evolved.
SHEFS-SA will focus on several key workstreams to achieve its objectives:
– Promoting Sustainable Farming Practices and Biodiversity Conservation
– Investigating the Connections between Diet, Nutrition, and Health Outcomes
– Enhancing Food Access and Affordability for Vulnerable Populations
– Collaborating with Policymakers to Support Sustainable and Healthy Food Systems
– Co-developing Solutions with Communities to Ensure Cultural Relevance and Acceptance
In addition to these primary components, SHEFS-SA will explore innovative technologies, sustainable business models, and climate resilience strategies. By leveraging advanced research and technology, the project aims to drive systemic change and establish resilient food systems capable of enduring future challenges.
IceAq – “Impact de la fonte glaciaire sur la dynamique des aquifères : modélisation glacio-hydrogéologique couplée dans le contexte du changement climatique”
PI Sophie Violette, PhD Clémence Daigre – Collaborations : Guðfinna Tolly Aðalgeirsdóttir (IES-Iceland University), Olivier Gagliardini (IGE-Université Grenoble)
Le projet IceAq s’intéresse aux aquifères dans les vallées glaciaires des glaciers tempérés, qui ont été jusqu’à présent très peu étudiés, bien que leur réponse au changement climatique soit importante à connaître pour prédire l’évolution des ressources en eau et les risques liés à l’eau de fonte. La première étape du projet IceAq a permis d’équiper un site pilote, véritable observatoire de la dynamique des écoulements sous-glaciaires, de surface et souterrains, situé au Sud-Est de la calotte glaciaire du Vatnajoküll (Island). Ainsi les différents aquifères ont été caractérisés, les termes du bilan hydrologique dans ce contexte glaciaire ont été quantifiés et un modèle conceptuel hydrogéologique a été proposé. Cette première phase a aussi permis de déterminer le type d’information, qui faisait défaut et dont l’acquisition serait des plus pertinentes et, d’identifier les nouveaux développements numériques nécessaires.
La seconde phase du projet multidisciplinaire développe une approche expérimentale de terrain et une approche de modélisation couplée entre les écoulements glaciaires et les écoulements souterrains. Le projet s’articule autour : i) du développement d’un modèle numérique permettant le couplage entre les écoulements glaciaires et souterrains sous forçages climatiques (modèle multiphysique ELMER/Ice avec composantes sous-glaciaire et souterraine), et ii) de la maintenance du site pilote d’observation pour acquérir des données originales, complémentaires et indispensables pour initialiser ou calibrer ou valider le modèle développé selon le type de données. Il s’agit notamment de mieux caractériser les chenaux sous-glaciaires, leurs dynamiques ainsi que de mesurer les débits des rivières situées à l’aval des glaciers. Les données acquises viendront compléter le jeu de données initial et disponible dans la base de données en “open access”.
HydroSéisme – “Compréhension d’un système aquifère volcanique sous climat tropical et impacté par des séismes régionaux”
Jérôme Fortin, Sophie Violette, PhD Emile Gros – Collaboration : Benoît Vittecoq (BRGM)
En contexte volcanique d’Arc insulaire, les séismes régionaux provoquent des modifications des propriétés hydrodynamiques des aquifères au cours du temps. Le projet a pour objectifs de : 1) comprendre un système d’aquifères volcaniques sous couverture d’altérites, 2) quantifier l’impact de la modification des propriétés hydrodynamiques des aquifères en réponse aux séismes et aux évènements extrêmes sur les flux et, 3) quantifier les flux d’eau et d’éléments en solution échangés aux limites et entre aquifères. Ainsi une meilleure gestion des ressources en eau, tant en quantité qu’en qualité pourra être proposée.
Sonder les Corps
PhD SACRE Art & Sciences Anna Ternon – Collaboration : ENS – INSERM Institut du Fer à Moulin
PEPR OneWater Eau Bien commun
OneWater – Eau Bien Commun est un programme national de recherche sur l’eau douce continentale copiloté par le CNRS, le BRGM et INRAE, avec 10 partenaires académiques. Face à des pressions climatiques et anthropiques accrues sur l’environnement, ce programme vise à développer des recherches dans le domaine de l’eau pour changer de paradigme et réhabiliter l’eau comme bien commun. Financé à hauteur de 53 millions d’euros sur 10 ans par le Plan France 2030, OneWater – Eau Bien Commun doit contribuer à accélérer les transitions et mesurer les impacts des changements globaux sur les socio-écosystèmes à travers 6 grands défis scientifiques. En renforçant le dialogue science-société, One Water contribue à fédérer une « communauté eau » multi-acteurs.
Le LG ENS est particulièrement impliqué dans le défi 1 Anticipation qui vise à anticiper l’évolution de la ressource en eau par l’amélioration des connaissances de sa variabilité passée et future. Il s’appuie notamment sur le développement d’un réseau de lysimétrie pour observer la recharge des nappes, de modélisations hydro(géo)logiques incluant les activités humaines, ainsi que de prévisions saisonnières. Un des enjeux de ce défi est le développement d’un réseau lysimétrique national.
Plateforme de modélisation hydrogéologique nationale AQUI-FR
Collaborations ITE à Strasbourg, Géosciences Rennes, Mines Paristech, LGENS, BRGM, CNRM, Météo-France et OFB
Le projet Aqui-FR est né du constat d’une mauvaise intégration des eaux souterraines dans la gestion de l’eau à l’échelle nationale, en partie liée à l’absence de modélisation hydrogéologique sur la totalité du territoire. En effet, les modèles hydrogéologiques sont généralement développés à l’échelle des aquifères pour répondre à des enjeux spécifiques de gestion locale et sont peu valorisés une fois les études terminées. Or, les eaux souterraines ont une dynamique propre, qui, une fois bien identifiée, peut permettre une certaine prévisibilité à l’échéance de plusieurs mois. Pour aller au-delà de cette échéance, il est nécessaire de bien anticiper la recharge de ces nappes. Les eaux souterraines contribuent à maintenir les débits d’étiages et à atténuer les crues en intensité si ce n’est en durée. Elles sont fortement sollicitées pour l’eau potable ou l’irrigation. L’anticipation de cette ressource est donc d’intérêt pour de nombreux acteurs, et pour la préservation de l’environnement. Il intègre maintenant 4 modèles hydrogéologiques : Marthe et Eaudyssée adaptés aux aquifères sédimentaires, Eros adapté aux aquifères karstiques, et depuis peu HS1D adapté aux aquifères de socle. Aqui-FR produit maintenant des prévisions saisonnières en continu, en mode pré-opérationnel.
https://www.geosciences.ens.fr/recherche/projets/aqui-fr
AQUIFEX – Estimation de la recharge d’un aquifère par approche de type « Schéma de surface »
Projet porté pour le LRC Yves-Rocard par Florence Habets (ENS) et Lionel Schaper (CEA)
Les méthodes d’évaluation de la recharge (part de la pluie efficace alimentant les eaux souterraines) peuvent être multiples. Si les méthodes basées sur l’étude des eaux de surface ou de la zone saturée semblent bien adaptées dans le cas d’aquifères poreux homogènes, on peut s’interroger sur leur pertinence dans le cas d’aquifères fissurés hétérogènes (différences pouvant être sensibles entre bassin versant hydrologique et bassin hydrogéologique, réponses piézométriques hétérogènes et difficulté d’estimer correctement l’emmagasinement, …). Les méthodes basées sur l’étude de la zone non saturée sont quant à elles, la plupart du temps, de portée locale et le changement d’échelle peut s’avérer délicat. A l’inverse, les méthodes basées sur les bilans de surface ne sont pas dépendantes du type d’aquifère étudié et sont de portée plus globale. Ainsi, l’objectif du présent projet est d’estimer la quantité de la recharge alimentant les eaux souterraines d’un site d’étude (aquifère fissuré hétérogène en Bourgogne) à l’aide d’un modèle de surface.
Explore2
Participation de Florence Habets
Le projet Explore2, porté par INRAE et l’Office international de l’eau (OiEau), s’inscrit dans la suite de l’étude Explore 2070 (2010-2012) grâce auquel les acteurs de la recherche, autour du ministère de l’Écologie, avaient établi des premiers scénarios prospectifs de disponibilités des ressources en eau à l’échelle de la France.
Le projet Explore2 a pour objectif, d’ici 2024, d’actualiser les connaissances sur l’impact du changement climatique sur l’hydrologie à partir des dernières publications du GIEC, mais aussi d’accompagner les acteurs des territoires dans la compréhension et l’utilisation de ces résultats pour adapter leurs stratégies de gestion de la ressource en eau.
Projet Evaporation des lacs
Collaboration de Florence Habets avec SMVSA, OFB
Les sécheresses récurrentes et le risque d’intensification de ces sécheresses avec le changement climatique pousse de multiples acteurs des territoires à construire de nouveaux réservoirs d’eau pour s’adapter. Cependant, ces plans d’eau peuvent avoir des impacts négatifs sur les milieux en termes de quantité et de qualité de l’eau. Parmi ces impacts, les pertes par évaporation peuvent nuire à la fonction même de ces plans d’eau. Ainsi, aux Etats-Unis, les pertes par évaporation des plans d’eau sont estimées correspondre à un volume équivalent à la consommation en eau potable du pays. Les facteurs contrôlant les pertes par évaporation sont liées à la température de l’eau, elle-même dépendante de la forme de la retenue, notamment, de sa profondeurs, et des modes des remplissages et de vidanges du plan d’eau, de l’exposition au vent et de l’ensoleillement, qui peuvent être affectés par l’aménagement des berges, et des autres conditions météorologiques comme l’humidité de l’air. L’objectif de ce travail est, en plus d’une détermination des pertes actuelles, d’envisager les configurations des futurs plans d’eau les plus favorables à une réduction de ces pertes.
Chaire Ardian – ENS “Stockage du carbone” 2024-2030
Portée par Jerome Fortin, avec la participation de Pierre Barré, Alexandre Schubnel, Bertrand Guenet, Samuel Abiven
Le 25 avril, l’École normale supérieure (ENS-PSL) a officiellement annoncé la création d’une nouvelle chaire de recherche dédiée au stockage du carbone dans les sols et le sous- sol, également connue sous le nom de Carbon Capture. La chaire bénéficie du mécénat d’Ardian, l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé. Cette initiative inaugure un partenariat de six ans pendant laquelle Ardian soutiendra les recherches pointues du laboratoire de Géologie, une composante du département de géosciences de l’ENS-PSL. L’objectif principal de cette chaire est d’approfondir la compréhension des mécanismes de stockage du carbone dans le sous-sol (stockage géologique) et les sols, un enjeu essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique.
https://fondation.ens.psl.eu/lancement-chaire-ardian-stockage-carbone-sol/
Dispersion and attenuation of elastic wave velocities
Porté par Jérôme Fortin et Samuel Chapman, Collaboration UNIL (Beatriz Quintal)
The importance of understanding well the attenuation/dispersion lies on the strong necessity to remotely characterize fluid-saturated rocks in subsurface using seismic methods. Knowledge of pore and fracture characteristics and their interconnectivity is of enormous significance, for example, to the development and production of geo-thermal resources as well as for the geological sequestration of CO2. We developed an apparatus for measurements over a large-frequency range, by the combination of forced oscillations (0.004 to 100 kHz in apparent frequency) and ultrasonic measurements (1 MHz) at various effective pressures. Several physical mechanisms are investigated : squirt flow, partial saturation, impact of fracture.
EARLY DIAGENESIS AS A PRECURSOR FOR AQUIFERS IN CARBONATE ROCKS
ANR JB Regnet (CYU), Jérôme Fortin
The goal of this project is to understand how carbonate aquifers develop and are further preserved following burial, with a particular emphasis on the precursor role of early diagenesis. Two questions are at the core of this project: (i) how do porosity and permeability evolve during early diagenesis and (ii) how are they further sustained over time considering mechanical compaction at depth? We address these questions through a unique investigation of the key factors conditioning the creation of porous and permeable units in carbonate rocks. The novelty of this approach is the simultaneous synthesis of analogous, controlled, carbonate microstructures with measurements of physical properties evolution.
Etude expérimentale intégrée de l’impact de l’altération des roches sur leurs propriétés hydromécaniques
Projet ENS/ IFPEN porté par Jérôme Fortin (ENS), Elisabeth Bemer (IFPEN) et Olivier Sissmann (IFPEN)
Les interactions fluides-roches sont au cœur de différents processus naturels (météorisation, karstogenèse, compaction chimique, diagenèse…) et anthropogéniques (stockage géologique du CO2, géothermie, réinjection des eaux de production…). L’écoulement de fluides réactifs au sein d’une formation rocheuse est susceptible d’induire des modifications drastiques de sa composition minéralogique et de sa structure poreuse, et subséquemment de ses propriétés hydromécaniques. L’objectif de ce travail est ainsi de développer une approche expérimentale intégrée permettant de comprendre l’effet d’un écoulement réactif sur la structure poreuse et les propriétés hydromécaniques des roches. Les transformations géochimiques considérées incluront des réactions de dissolution et/ou de précipitation.
Les projets passés
REPRISE – Financement : STIC-AmSud / Pilotage : Bertrand Guenet
Les changements climatiques futurs sont principalement prévus par des modèles du système terrestre. Les climatologues ne se fient pas à un seul modèle et plusieurs modèles ont été développés dans le monde. Grâce à l’ensemble de plusieurs modèles, nous pouvons calculer les trajectoires climatiques futures et les incertitudes associées. Une source d’incertitude provient de la structure des modèles et de la manière dont les différents mécanismes sont représentés et paramétrés. L’un des principaux défis des climatologues est de réduire ces incertitudes. Une option possible est le développement de modèles, mais cela prend du temps et nécessite d’importantes ressources informatiques et humaines. La deuxième option est de contraindre les projections du modèle sur la base des observations actuelles, afin de calculer les biais et de corriger ensuite les données modélisées. Cette approche est connue sous le nom de cadre de contrainte émergente. Dans le cadre de la collaboration REPRISE, nous allons analyser les simulations actuelles du modèle du système terrestre et analyser différentes variables de sortie liées au cycle du carbone, à l’usage des terres et au climat, qui seront comparées aux produits basés sur les observations. Ce travail sera effectué par le biais deux work packages. Le premier se concentrera sur le cadre de contrainte émergent pour réduire les incertitudes dans les projections futures, pour des variables de sortie et des régions spécifiques. Le second se penchera sur les résidus de modèle et identifiera leurs facteurs pour souligner les aspects spécifiques des modèles du système terrestre qui doivent être améliorés pour réduire les incertitudes des projections climatiques. Ces deux ensembles de travaux seront réalisés avec un accent particulier sur l’Amérique du Sud afin de réduire les incertitudes liées au changement climatique dans cette région. Deux work packages supplémentaires dédiés à la recherche de financement et à la communication/diffusion des résultats seront également inclus pour assurer la continuité du consortium actuel après le projet REPRISE et pour atteindre les parties prenantes locales.
CHROME – Financement : Marie Skłodowska-Curie / Pilotage : Nuria Catalan
Le carbone organique est exporté des écosystèmes terrestres vers les écosystèmes d’eau douce où il est non seulement dégradé et finalement perdu sous forme de dioxyde de carbone, mais où cette dégradation se produit également plus rapidement que dans les sols ou les systèmes marins. Dans les eaux douces, les variations de la dégradation et de la réactivité de la matière organique ont été liées aux changements de composition de la matière organique. Le flux des systèmes terrestres vers les systèmes aquatiques semble augmenter en raison des perturbations anthropiques. Cependant, malgré l’importance de ces flux pour le cycle global du carbone, les modèles du système terrestre (ESM) commencent à peine à les prendre en compte. En ce sens, l’Arctique est une région particulièrement cruciale qui mérite une attention urgente, car les sols du pergélisol contiennent un stock massif de carbone qui est susceptible d’être mobilisé vers les eaux douces. Un tel transfert pourrait transformer ce stock de carbone vulnérable d’un puits en une source de dioxyde de carbone. Par conséquent, déterminer la réactivité de ce flux de matière organique et l’incorporer dans les modèles de surface est essentiel à l’heure actuelle. Le fondement de CHROME est l’idée que la diversité chimique de la matière organique explique sa réactivité et, à ce titre, doit être prise en compte dans les modèles biogéochimiques. CHROME représente la première tentative d’incorporer la diversité chimique de la matière organique dans les MSE, et le fera en : i) développant et en sélectionnant des indices de diversité chimique fonctionnelle comme indicateurs de la réactivité de la matière organique arctique et ii) en mettant en œuvre ces connaissances dans une branche régionale d’un MSE.
CCiCC – Financement : H2020 / Pilotage : Pierre Friedlingstein
Le projet CCiCC vise à combler le manque crucial de connaissances sur la sensibilité du climat aux émissions de dioxyde de carbone, en réduisant l’incertitude de notre compréhension quantitative des interactions et des rétroactions carbone-climat. Cet objectif sera atteint par une intégration innovante des modèles et des observations, en fournissant de nouvelles contraintes sur les interactions carbone-climat modélisées et les projections climatiques, et en soutenant les évaluations du GIEC et les objectifs politiques. Pour atteindre cet objectif, CCiCC (a) apportera un changement radical dans notre capacité à quantifier les processus clés qui régulent le système couplé carbone-climat, (b) utilisera les contraintes d’observation et une meilleure compréhension des processus pour fournir des prévisions à court terme et des projections à long terme multi-modèles du climat en réponse aux émissions anthropiques, et (c) fournira des voies d’émissions de dioxyde de carbone pertinentes pour les politiques, en accord avec les objectifs de l’Accord de Paris (AP) de la CCNUCC (Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques). Pour atteindre ses objectifs, le CCiCC développera et utilisera : des modèles du système terrestre (MST) de pointe, y compris des processus biogéochimiques non inclus dans les précédents rapports du GIEC ; de nouvelles observations pour limiter le cycle du carbone contemporain et sa variabilité naturelle ; des prévisions décennales basées sur les MST, y compris les rétroactions carbone-climat et de nouvelles méthodes d’initialisation ; de nouvelles contraintes émergentes et méthodes de pondération pour réduire l’incertitude dans les projections du cycle du carbone et du climat ; et de nouveaux scénarios climatiques suivant des voies d’émission de CO2 adaptatives. Le CCiCC soutiendra deux éléments centraux de l’AP. Premièrement, les bilans mondiaux de l’AP, en fournissant des prévisions pertinentes pour les politiques en matière de CO2 atmosphérique et de climat en réponse aux contributions nationales déterminées. Deuxièmement, les ambitions de l’AP de maintenir le réchauffement de la planète bien en dessous de 2°C, en fournissant des estimations solides des budgets carbone restants et des voies disponibles. Le CCiCC rassemblera des groupes européens de premier plan dans le domaine de la modélisation du climat et de la recherche sur le cycle du carbone, assurant ainsi de manière unique le leadership de l’Europe dans le domaine de la science pratique nécessaire aux évaluations du GIEC.
HoliSoils – Financement : H2020 / Pilotage : Raisa Mäkipää
Le manque de connaissances sur les processus des sols forestiers et l’absence d’une surveillance harmonisée des sols limitent la capacité de l’UE à maintenir les services écosystémiques liés aux sols et à atteindre les objectifs de la politique climatique. Une meilleure compréhension des processus pédologiques et une approche harmonisée de la gestion et de l’intégration des données dans les modèles de calcul utilisés pour la prise de décision sont nécessaires de toute urgence pour atteindre les objectifs en matière de climat et de durabilité, y compris les ODD de l’Agenda 2030 des Nations unies, l’accord de Paris de la Convention sur le climat, la stratégie de l’UE en matière de bioéconomie, le règlement UTCATF de l’UE, la stratégie forestière de l’UE (2018) et le contrat vert européen. HoliSoils développera un cadre harmonisé de surveillance des sols et identifiera et testera des pratiques de gestion des sols visant à atténuer le CC et à maintenir la fourniture de divers services écosystémiques essentiels aux moyens de subsistance et au bien-être des humains. HoliSoils intègre de nouvelles méthodologies et des connaissances spécialisées sur les techniques d’analyse, le partage des données, les propriétés et la biodiversité des sols, ainsi que les processus de développement de modèles, afin de développer des outils de surveillance des sols, d’affiner l’évaluation des GES du secteur UTCATF, d’accroître l’efficacité des mesures d’atténuation des GES et d’améliorer les prévisions numériques de l’atténuation, de l’adaptation et des services écosystémiques basés sur les sols. HoliSoils applique une approche collaborative multi-acteurs, afin de maximiser son applicabilité et son impact au-delà de sa durée. Le consortium multidisciplinaire se compose d’universités et d’instituts de recherche de toute l’Europe, avec une expertise de premier plan en matière d’analyse des sols et de bases de données, de développement de techniques analytiques avancées, de modélisation de systèmes complexes, de cartographie numérique des sols, d’écologie des sols, d’écologie des perturbations, d’inventaires des forêts et des GES, de sciences sociales et de communication. Il implique également un engagement actif avec diverses parties prenantes, notamment des propriétaires et des gestionnaires de forêts, des acteurs de l’industrie, des services d’extension forestière, un organisme de certification, des chercheurs dans le domaine des forêts et des sols, des experts en matière de soutien à la politique climatique et d’inventaire des GES, ainsi que des décideurs politiques.
ROCOCO – Financement : ADEME / Pilotage : Lauric Cecillon
Alors que le Programme national de la forêt et du bois vise à augmenter les prélèvements de bois en France, l’étude 4p1000 France souligne l’importance de surveiller les effets d’une gestion sylvicole qui s’intensifie sur les stocks de carbone organique du sol (COS) ; avec pour objectif de préserver ou renforcer le puits net de COS que constituent les sols forestiers français. Pourtant, la surveillance des effets d’une mobilisation accrue de biomasse en forêt sur le stock de COS est rendue très difficile car il n’existe pas de modèle de dynamique du COS validé dans les conditions des forêts françaises. Notre projet ROCOCO vise à lever le verrou scientifique d’une modélisation de la dynamique du COS défaillante en forêt. A ce titre, il s’inscrit dans l’Axe 2 de l’APR GRAINE. Il porte tout particulièrement sur une des Priorités de l’Edition 2019 concernant la gestion forestière et les filières bois : la « modélisation des effets de la gestion forestière sur le carbone du sol ». Les objectifs du projet ROCOCO sont aussi simples qu’ambitieux : améliorer les modèles de dynamiques du COS pour les rendre enfins prédictifs des évolutions observées dans les forêts françaises (en les rendant compatibles avec une méthode quantifiant la stabilité du COS et en les simplifiant) ; utiliser les modèles améliorés pour simuler les évolutions des stocks de COS de l’ensemble des forêts françaises à l’horizon 2050 sous différents scénarios de gestion forestière et de climat. Notre projet ROCOCO offrir a ainsi à l a communauté scientifique et aux gestionnaires forestiers d e s modèles de dynamique du COS opérationnels, ainsi que des projections robustes des évolutions des stocks de COS à l’horizon 2050 sous différents scénarios climatiques et de gestion forestière. Ces projections seront à même d’éclairer plus objectivement les politiques publiques visant l’augmentation des prélèvements de bois en France au regard de leur compatibilité avec la stratégie nationale bas carbone.
Chaire Channel – Financement : Fondation Channel / Pilotage : Laurent Bopp
L’océan modère et contrôle le calendrier du changement climatique anthropique. Il a absorbé la grande majorité de l’excès de chaleur du système climatique, soit plus de 90 % depuis les années 1970. Il constitue également un énorme puits de carbone : chaque année, il absorbe plusieurs milliards de tonnes de carbone. Il a capté près de 30% des émissions anthropiques de carbone depuis le début de la période industrielle, réduisant ainsi considérablement l’augmentation de la concentration de CO2 dans l’atmosphère. L’impact modérateur des océans sur le changement climatique anthropique a un coût : ils se réchauffent en absorbant de la chaleur et s’acidifient en absorbant du carbone. Ces changements des propriétés physico-chimiques fondamentales de l’océan (réchauffement, acidification) ont des répercussions sur le fonctionnement des écosystèmes et sur les espèces marines en modifiant leur répartition géographique, leur physiologie de base et leurs rythmes saisonniers. Néanmoins, l’océan est aussi une source de solutions potentielles pour atténuer le changement climatique. Les écosystèmes côtiers, les mangroves, les marais salants, les herbiers marins et les macroalgues constituent ce que l’on appelle le « carbone bleu ». En protégeant et en restaurant ces écosystèmes très productifs, on pourrait augmenter considérablement la capacité de stockage du carbone de la Terre et réduire le taux d’augmentation du CO2 dans l’atmosphère.
Malgré des avancées significatives, notre compréhension du rôle de l’océan dans les projections de changement climatique pour les prochaines décennies est encore limitée. Quelle sera l’évolution du puits de carbone océanique au cours du 21e siècle ? Quels seront les impacts de l’acidification des océans sur les écosystèmes marins ? De même, la quantification du rôle potentiel du « carbone bleu » dans l’atténuation du changement climatique est encore très incomplète. Cette quantification est principalement basée sur des données de terrain locales qui ont été extrapolées à l’ensemble du globe. Comment pouvons-nous améliorer nos estimations du carbone bleu ?